FEMMES AU BÉNIN
Des amazones contre vents et passé

Pendant que nous traversons le département du Couffo, là où prospèrent au-delà de 15 000 champs d’agrumes, Duince Ahossouhe se retourne. « Ici, c’est l’une des régions les plus surpeuplées du pays. Il y a beaucoup de polygamie », explique-t-il.
Sans le vouloir, notre surprise transparaît.
« Les hommes sont principalement aidés par les femmes au champ. La femme doit donc aller aider l’homme d’abord avant de pouvoir avancer son champ à elle. Pour alléger leur tâche, les femmes autorisent donc l’homme à prendre d’autres épouses », résume celui qui défend les intérêts des jeunes agriculteurs du Bénin en tant que président du Collège des jeunes agriculteurs.
Un peu plus tard pendant le séjour, alors que nous sommes assis dans un restaurant dans les Collines, l’attitude nonchalante de la femme qui nous sert rend le groupe plutôt perplexe. Même les larges sourires et les blagues n’y font rien. Ce n’est que le lendemain qu’Abdoul, qui accompagne le groupe, nous explique. « C’est la première femme du propriétaire. Et il vient d’en prendre une deuxième… qui travaille avec eux. »
Personne n’avait songé à ça. Pourtant, c’est le cas de deux Béninoises sur cinq (38 %). De ces femmes, 10 % ont deux coépouses ou plus.

D’autres exemples de la vie en tant que femme au Bénin? La prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) au pays, chez les 15 à 49 ans, était de 9,2 % en 2014 selon la Banque mondiale.
En décembre 2021, le gouvernement Talon a même criminalisé toute MGF, comme l’ablation totale ou partielle du clitoris, rendant ces actes passibles de six mois à cinq ans de prison dépendamment de l’âge de la victime. En plus des raisons culturelles, le gouvernement expliquait encore en 2021 l'existence de ces pratiques par des motivations économiques, comme la revente du clitoris à des fins de rituel.
Or, des actions de sensibilisation continuent d’être nécessaires par l’État, comme la tenue annuelle d’une « Journée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines », alors que la tradition se montre forte dans certaines régions du pays.
Les iniquités hommes femmes sont toujours bien présentes au Bénin, mais en fières héritières des amazones du Dahomey, des femmes ambitieuses parviennent à se frayer une voie pour tenter de changer les choses. En voici quelques-unes.
1
Renverser l’éducation
Lorsqu’interrogée sur la fréquence d’injustices qu’elle a pu vivre en raison de son genre, Marianique Behanzin répond, déterminée : « ça ne se compte pas, mais je ne me laisse pas faire. »
La jeune femme est agroéconomiste, enseignante au Lycée agricole Mèdji de Sékou (LAMS) et entrepreneure. Elle est aussi mentore pour le programme AWEP-Benin des Nations Unies, qui vise à soutenir les femmes dans le démarrage d’entreprises en leur donnant notamment accès à du financement. Sur 100 enseignants, son établissement compte 20 femmes.
« La question du genre dans le contexte africain, et particulièrement au Bénin, reste toujours délicate, parce que certaines réalités ne sont pas faciles à aborder. Il y a encore des stéréotypes et des idées préconçues qui existent toujours et qui prédominent. Ce sont des freins à l’équité entre les filles et les garçons », dit celle qui enseigne notamment l’impact du genre et du VIH en agriculture.
Celle-ci s'intéresse notamment à la situation des femmes dans les communautés peules, qui vivent de l'élevage des bœufs par les hommes. « Elles sont dans un régime patriarcal dominant et n'ont pas droit à la parole ni aux prises de décisions. Vivant dans des ménages polygamiques, elle sont parfois limitées à la procréation et elles ont un accès limité à l'éducation et aux ressources. Compte tenu de leurs traditions, elle refusent même parfois de se faire examiner par des docteurs du sexe masculin. »
Lors d'une visite dans le campement peul de Foki, La Tribune a elle-même pu constater la place que les femmes occupent dans ces communautés.
Pour la chercheure, il faudrait d'aborder aider ces femmes à s'émanciper davantage dans leur domaine, soit la production de fromage et la commercialisation de plantes médicinales. « On doit faire de la sensibilisation, donner la parole aux femmes pour écouter leurs besoins, les aider à améliorer leurs produits, avoir un véritable plan de développement participatif et instruire leurs enfants. »
À l'échelle du pays, la solution réside également dans l’éducation aux filles et aux garçons, croit-elle. « Il faut éduquer les garçons à la masculinité positive par exemple. Susciter des jeux entre filles et garçons pour mieux se connaître, arriver à travailler ensemble pour que chacun puisse respecter l’autre et la personnalité de l’autre dans son individualité », dit-elle.
Un projet autour de l'humain
L'entrepreneure souhaite mettre son propre projet agricole sur pied, dans les prochaines années, qui consiste en une ferme intégrée avec un volet agrotouristique à Zogbodomey. Toute la production serait transformée sur place.
« Être femme et entrepreneure, ce n’est pas toujours facile. Il faut s’organiser. Il faut savoir se donner des priorités et faire les bons choix. Ma passion m’a conduite à ça parce que c’est la vision que j’ai. J’ai envie de créer une entreprise dans laquelle beaucoup de jeunes pourront se retrouver. Si un individu n’est pas épanoui, il ne peut pas être heureux. Et c’est ça qui va influencer sa vie de famille. Ma vision ne se limite pas qu’à l’individu. Ça vise la famille, la société et la collectivité en général. »
Ce qui comprend les femmes, précise-t-elle évidemment.
« Je veux que leur revenu d’abord soit satisfaisant. Qu’il leur donne le meilleur possible. Je vois une entreprise qui a la personne au cœur de ses intérêts. »
Celle-ci croit aussi que les coopératives sont une solution efficace à prioriser pour la réussite des femmes en affaires et en agriculture. « Quand on travaille ensemble, il y a plus d’avantages, les pertes sont partagées, il y a moins de risques. Ça permet aussi d’avoir plus d’ouverture, plus de sensibilité et de diversité, notamment dans les idées. En plus de l’aspect du financement, qui permet d’assumer ensemble. »

2
Changer les rapports de force

Cette année, l’Assemblée nationale a dépassé pour une première fois les 10 % de sièges occupés par des femmes, grâce à l’instauration de 24 sièges, soit un par circonscription, réservés exclusivement aux femmes. Actuellement, elles sont 28 femmes sur 109 députés (25,69 %).
En lutte constante pour faire avancer les droits des jeunes agricultrices comme elle, Arcelle Agounkpleto croit qu’il est crucial d’instaurer ce genre de systèmes de discrimination positive, tant pour les jeunes que pour les femmes dans son domaine. Tous et toutes doivent être davantage accompagnés par les institutions et être inclus dans la prise de décisions, plaide-t-elle.
Béninoise moderne, Arcelle a elle-même décidé d’aborder la vie selon sa propre vision, à Bohicon. Symbole fort : ce n’est qu’à quelques kilomètres du palais royal où ont évolué les Minon, soit l’armée d’amazones ayant notamment combattu les colons français, et dont l’audace et la force font aujourd’hui la fierté du pays.
L’entrepreneure élève son garçon en garde partagée, tout en assurant la relève de l’entreprise de sa mère et en tenant sa propre boutique de produits locaux. Les défis sont nombreux, avoue-t-elle, et le temps passé à la maison n’est pas à la hauteur de ses souhaits, mais elle n’hésite pas à qualifier sa maternité de sa « plus grande réussite ».
« J’ai décidé d’élever mon garçon dans l’amour. Au Bénin, les enfants ne sont pas proches de leurs parents. On ne leur donne pas de caresses ou de mots d’encouragements. Moi, j’ai décidé de le faire. »
Celle-ci a notamment été largement inspirée par les réseaux sociaux, de même que la télévision occidentale. « J’ai beaucoup appris en écoutant Supernanny, dit-elle. J’ai appris que c’était important de prendre du temps pour des activités seulement pour lui et moi. On sort de la maison et ce moment est consacré à nous deux. Normalement, ici, les gens ne font pas ça. »
Avec cette approche éducative, Arcelle est convaincue que son garçon sera beaucoup plus sensibilisé à la condition féminine et fera partie d’une relève porteuse de changements sociaux.


3
Défier la tradition
«Tu es une femme, donc tu ne peux pas être propriétaire, tu ne peux pas gérer. C’est directement dans la culture des Béninois de se dire que les femmes ne peuvent pas gérer quelque chose, elles doivent être sous quelqu’un. »
Hillary Toto n’est évidemment pas en accord avec cette mentalité, elle qui remercie son père d’avoir vu les choses différemment. Celle-ci aura la chance de reprendre la ferme de son père Bernadin Toto, à Abomey-Calavi… même si elle a un frère.
Du point de vue légal, les Béninoises ont un accès à la propriété égal aux hommes depuis l’adoption du Code des personnes et de la famille, en 2004. Malgré cela, tous les intervenants consultés s’entendent que des murs persistent pour les femmes, là où tradition et patrimoine familial dominent.
Lawani Arouna, le président de la Plateforme nationale des organisations paysannes et professionnelles agricoles du Bénin (PNOPPA), qui chapeaute tous les regroupements de producteurs du pays, en est bien au fait.
« Quand les femmes se marient, elles portent le nom de leur mari, donc elles quittent, explique-t-il d’abord. Si on partage les terres de la famille et qu’on lui en donne une partie, on rétrécit le patrimoine de cette famille-là, tandis qu’elle agrandit plutôt le patrimoine de l’autre famille. Il y a cette mentalité qui est encore là. »
« Mais on a une chance quand même, au Bénin, c’est que quand vous avez les moyens d’acheter la terre, personne ne va vous empêcher de l’acheter, homme comme femme relativise-t-il. Mais sur le plan des coutumes, c’est bien difficile. Toutes les familles ne sont pas encore prêtes. C’est vrai que dans certaines d’entre elles, on fait plutôt une différence et on sépare les terres entre tous les enfants. »

Lawani Arouna, président de la PNOPPA-Bénin
Lawani Arouna, président de la PNOPPA-Bénin
Et on laisse la chance aux femmes, comme Hillary.
« Pour mon père, que tu sois homme ou femme, c’est pareil. On est quatre filles et un garçon, et on est tous ici à travailler quand on peut. C’est sa mentalité qui a fait que c’était plus facile pour moi. J’ai eu cette grâce », reconnaît-elle.
Au départ, celle-ci n’avait même pas prévu devenir agricultrice. Diplômée en informatique, un milieu largement masculin, la jeune femme a cependant renoué avec la terre récemment.
Depuis, elle passe une grande partie de son temps auprès des porcs, des dindons, des poulets, des chèvres et des pintades de la famille.
Pourquoi ne pas combiner ses deux passions? S’est dite celle qui prévoit d’ailleurs aller réaliser sa maîtrise au Canada.
« Pour le moment, je travaille sur un système de bâtiments intelligents. Je travaille sur comment réguler la température dans les enclos », s’illumine-t-elle.
Comment faire pour que davantage de femmes suivent ces pas? Plus de sensibilisation répond-elle.
« Il faudrait aussi permettre à des femmes qui sont déjà propriétaires d’aller montrer leur projet, de montrer qu’elles ont pu le faire. »

4
Peu sensibilisées, mais plus respectées


Pierrette Agbovoedo
Pierrette Agbovoedo

Rosteck Houndode
Rosteck Houndode
Pierrette Agbovoedo se montre timide au départ, assise dans son siège d'étudiante à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, mais elle formule rapidement le fond de sa pensée. « Je pense que les femmes se sentent faibles. Elles se disent qu’elles ne peuvent pas le faire. Mais si on se donne, on va tout faire. »
Dans cet établissement, les femmes étudiantes sont minoritaires, mais elles sont davantage respectées que les hommes, insistent Pierrette et ses collègues. Comme les défis sont plus grands, leur détermination ne laisse personne indifférent.
Pourquoi sont-elles si peu?
« Les parents n’ont pas compris. Aller dans ce genre de milieu, pour les femmes, c’est un peu compliqué. C’est caché. Dans la zone ici, l’égalité est moins reconnue. Moi-même, je n’ai connu cette école que l’an dernier », réfléchit celle qui rêve de devenir vétérinaire pour les animaux de ferme.
« On n’est pas assez sensibilisées, ajoute sa camarade Rosteck Houndode. C’est rare de trouver des femmes agronomes, mais de là, on a la possibilité d’être internationales. »

5
Du chemin à faire

Carianne Lemire, jeune maraîchère de Saint-Michel, en Montérégie, a été plutôt ébranlée par la condition féminine du Bénin. « Déçue », est même le terme qu'elle emploie lorsqu'on lui demande ses impressions, au terme du séjour qui l'aura mené dans sept départements et une quinzaine d'entreprises agricoles.
Sa mission de coopération internationale, qui est une collaboration entre la Fédération de la relève agricole du Québec et UPA Développement International, sera certainement l'occasion de contribuer davantage au progrès réalisé dans les derrières années, mais qui s'avère toujours insuffisant.
Voyez ses impressions.
Images : Maxime Picard, Montage : Jean Roy, Journaliste : Jasmine Rondeau
Images : Maxime Picard, Montage : Jean Roy, Journaliste : Jasmine Rondeau
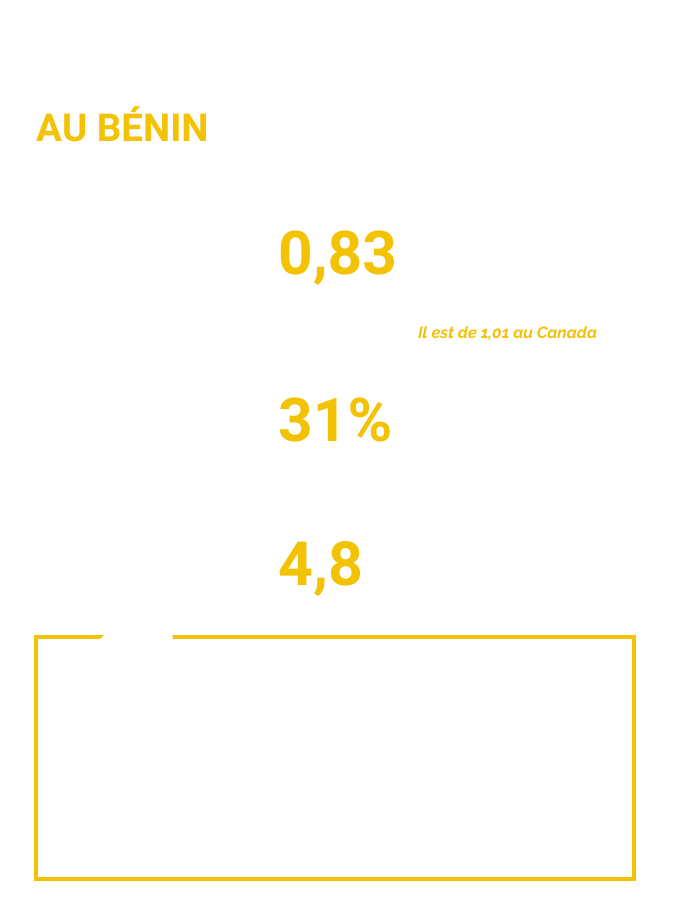

Pendant deux semaines, neuf jeunes de la relève agricole québécoise ont traversé le Bénin dans l’optique de tisser des liens qui aideront le pays à défendre son agriculture familiale en contexte de changements climatiques, de mondialisation et de course à la croissance économique. La Tribune les a accompagnés et y a fait la découverte des élevages, des cultures et des humains qui constituent la résilience béninoise. Ce reportage a été rendu possible grâce à Affaires mondiales Canada et UPA Développement international.
