BÉNIN
Une nation et sa quête de sécurité alimentaire

COTONOU — Au Bénin, l’agriculture est remplie de promesses pour la croissance économique du pays. Son expertise, ses terres fertiles et son climat tropical sont devenus les munitions de son président, Patrice Talon, pour relever ce pays qui n’a que 63 ans d’indépendance. Mais dans les campagnes, la relève agricole se demande comment elle survivra assez longtemps pour aider un jour sa patrie à atteindre la véritable sécurité alimentaire.
Avec une population composée à 65 % de jeunes de moins de 25 ans, le Bénin devra compter sur plusieurs productions en démarrage pour réaliser ses ambitions. Mais tout n’est pas si simple, explique Duince Ahossouhe, président du Collège des jeunes agricultures du Bénin (CJA).
Qu’est-ce qui les freine? Tellement de choses, explique-t-il. Remédier aux problèmes d’apport en eau est nécessairement la priorité, mais aussi l’accès aux autres facteurs de production, notamment l’équipement.
« On ne peut pas continuer à travailler avec la daba et la machette », déplore le maraîcher et éleveur de lapins, de volaille, de chèvres et de porc.
Sur la forte majorité des fermes, la daba, aussi appelée houe, est le principal outil de travail pour labourer, sarcler et aménager les planches au champ. Rien d’ergonomique, constatent les jeunes agriculteurs québécois en visite.

La daba
La daba
Au lycée agricole d’Adja-Ouèrè, la daba est même l’outil mis à la disposition des élèves, en attendant que l’établissement réalise un jour son grand projet d’expansion.

Le recensement agricole 2021 du Bénin indique que la mécanisation des travaux du sol en culture végétale n'est instaurée que dans 12,41 % des fermes. La presque totalité de ce nombre se situe au nord du pays, où les terres sont plus vastes. Pour une majorité de cultures, le travail s'avère ainsi colossal.
À la ferme Olashade, à Tori-Bossito, Bernadin Toto regarde avec fierté son champ d’igname, un tubercule très consommé qui s’apparente au manioc et à la patate douce.
Comme le sol est trop dense, les ignames sont plantées dans de grands buttons surélevés. Pour une plantation qui devrait fournir 1500 tubercules dès le mois d’août, il aura fallu deux hommes et deux jours de travail manuel pour la mise en terre, en janvier.
Ironie : malgré tout ce temps de travail, les agriculteurs ne profitent pas de leurs produits, fait remarquer Duince Ahossouhe. Pas par crainte, mais par réflexe financier. « Le producteur préférera toujours vendre sa papaye plutôt que de la consommer », explique-t-il.
D’ailleurs, de nombreux fruits et légumes cultivés au pays n’ont pas leur place dans l’assiette des Béninois.
« Quand les gens mangent, ils se limitent à la protéine et à l’apport d’énergie », décrit M. Ahossouhe, qui réclame une grande opération de sensibilisation à l’alimentation saine et diversifiée.
Somme toutes, M. Ahossouhe se montre clair : écartons les stéréotypes de famine dans son pays, demande-t-il. « On mange bien et on ne manque pas de nourriture ici », ce sont plutôt les produits de l'extérieur qui occupent une trop grande place.
De grandes quantités de produits étrangers, comme de la viande congelée américaine ou du riz thaïlandais et indien continuent en effet d’être importés à faibles coûts pour nourrir la population, tandis que d’énormes quantités de produits alimentaires sortent des frontières en quête de revenus.

1
Ne transforme pas qui veut


L’enjeu des ressources et équipements est tout aussi présent chez les transformateurs, qui sont aussi représentés par les organisations paysannes du pays vu leur taille artisanale.
Dans l’entreprise familiale de préparation de tofu Marie-Jérôme Agro, dont Arcelle Agounkpleto est la relève, le charbon brûle à fond sous les marmites. Bien que le mercure affiche déjà 40 degrés à l’extérieur, la température monte d’un cran en pénétrant dans cet enclos à fumée.
« L’objectif le plus pressant pour nous aujourd’hui, c’est de pouvoir quitter ces lieux et avoir un espace approprié. On veut aussi mécaniser certains processus. C’est en moyenne 150 ou 200 kilos par jour et c’est très difficile physiquement », avance Mme Agounkpleto, ajoutant rêver d’un jour exporter ses fromages de soja local et naturel.
Mais pour le faire, elle et sa mère ont besoin de beaucoup de ressources. Les prêts ne sont pas une option, vu les conditions d’emprunts trop difficiles et les revenus qui sont à la merci d’un marché en dents de scie.
« Atteindre la sécurité alimentaire du pays, c’est possible... mais, réfléchit Arcelle Agounkpleto. La majorité des jeunes font des petites productions. Si on reste à l’étape artisanale, ça va être compliqué, à moins qu’on passe à l’industrialisation. Mais on n’a pas les moyens. Il faut forcément un accompagnement. »
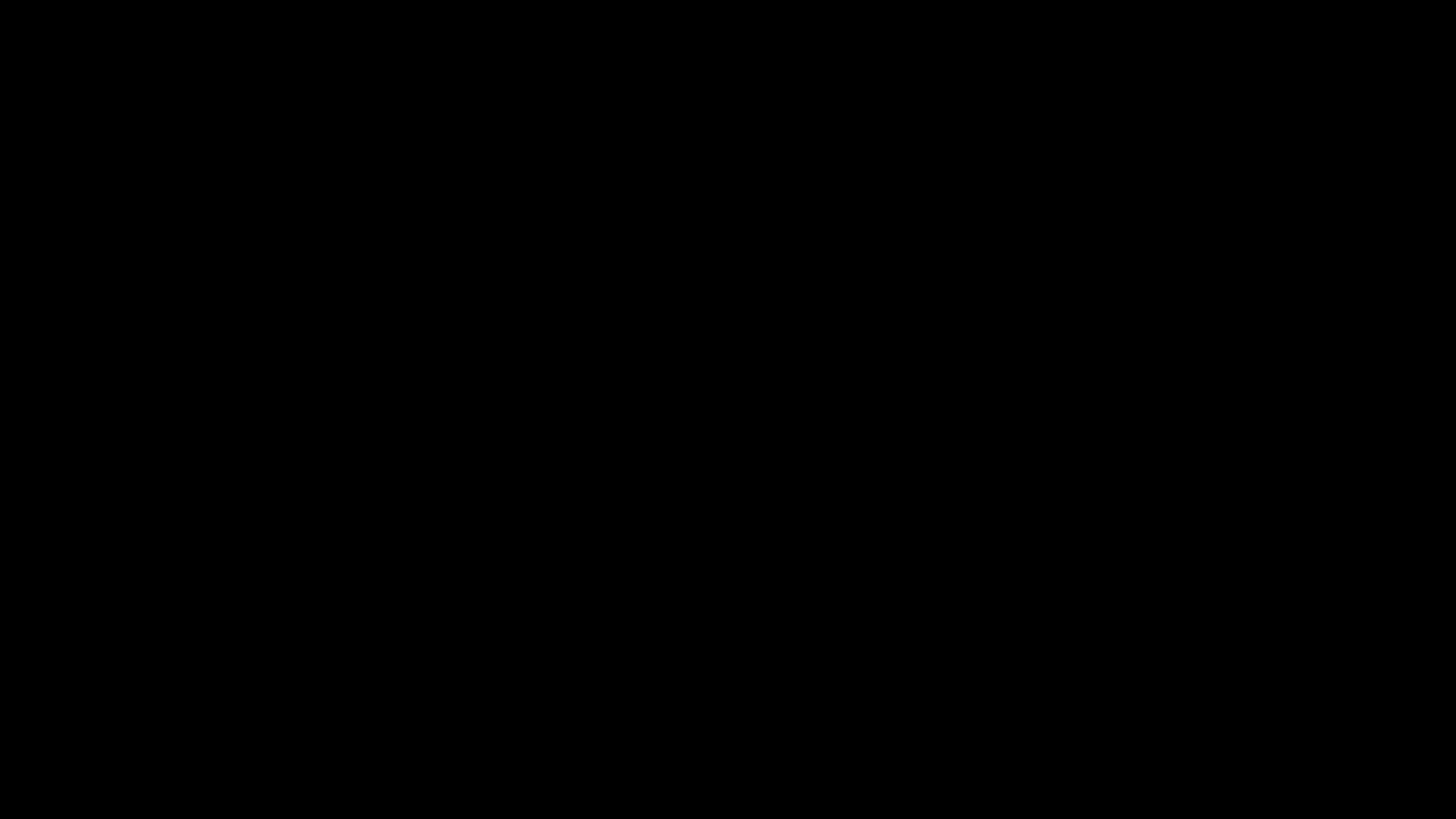
2
Conditions difficiles
Il faut parcourir un étroit chemin de terre hautement accidenté sur plusieurs kilomètres avant d’atteindre les installations de la Coopérative IRETY Productions Farm, à Glazoué. S’il pleut, il faudra probablement y passer la nuit, préviennent les guides. « Vous voyez dans quelles conditions plusieurs producteurs doivent vivre? » laisse tomber Arcelle Agounkpleto, qui accompagne le groupe en tant que membre du CJA.
La coopérative, présidée par une femme, se spécialise entre autres dans la transformation de manioc, dans les boissons artisanales et dans la production animale. Son produit phare, la farine panifiable de manioc, a été identifié comme l’une des principales alternatives locales à la farine de blé importée de la mer Noire. D’autant plus que le pays produit annuellement plus de 4 millions de tonnes de ce légume racine, qui constitue la base de l’alimentation de la moitié de sa population.

Le gouvernement a même formulé un décret en 2008 autorisant l’intégration à 15 % de farines locales dans les pains. Mais rien de tout ça n’est appliqué, explique Euloge Zomahoun, travailleur coopérant.
« Avec la flambée du prix du blé, beaucoup ont un regard tourné vers la farine de manioc. Mais l’incorporation demeure un problème, malgré les formations données par l’état aux boulangers et pâtissiers. Au Nigéria, au Cameroun et au Sénégal, ce l’est. Les boulangers disent qu’ils aimeraient bien l’incorporer, mais que jusqu’à présent, il n’y a pas suffisamment de volume disponible pour leurs besoins. Les producteurs sont donc obligés d’écouler leur farine auprès des petits transformateurs », note-t-il, ajoutant que les initiatives manquent à la base pour stimuler la production de farine locale.
Sans économie d'échelle, l'utilisation de celle-ci demeurerait ainsi plus coûteuse que la farine de blé, pour le moment.
Pour survivre et rembourser ses prêts, l’entreprise doit toujours penser à se diversifier. Depuis peu, elle a installé des ruches sur son terrain. Elle espère également développer un volet agrotourisme à son site, malgré son caractère éloigné.

3
Abandon élevé

« L’entrepreneuriat agricole chez nous, ce n’est pas qui veut, c’est qui peut, résume Duince Ahossouhe. Tu peux perdre banalement dix ans de ta vie à ne pas pouvoir vivre décemment de ton activité. Pendant ce temps, tu vois tes collègues de classe qui sont allés en finance et qui sont bien rémunérés dans des entreprises. C’est décourageant. »
Après huit ans d’études spécialisées en agriculture, lui-même a dû vendre du charbon pendant trois ans avant de s’offrir une terre agricole à Kétou. « Pour être rentable, il faut avoir au moins 40 femelles. Moi, je n’ai commencé qu’avec 5 et j’ai mis au moins 5 ans avant d’en avoir 40 », raconte-t-il.
Le président de l’Association des jeunes agriculteurs modèles du Bénin, qui est membre du CJA, Eustache Hounkpatin, explique qu’il constate un fort taux d’abandon des agriculteurs après trois à cinq années d’existence de leur entreprise. « Sur dix jeunes qui vont en agriculture, sept le font parce qu’il n’y a pas d’autres opportunités pour eux. Aux premières difficultés déjà, n’ayant pas cette volonté de créer une entreprise et de faire face aux défis, ils abandonnent. »
« Tu peux perdre banalement dix ans de ta vie à ne pas pouvoir vivre décemment de ton activité. »

Il est possible de poursuivre des études agricoles dès le lycée, au Bénin, avant de se diriger vers l'université. Certains étudiants en situation précaire y ont accès grâce à des bourses, tandis que d'autres doivent débourser pour leur éducation.
Il est possible de poursuivre des études agricoles dès le lycée, au Bénin, avant de se diriger vers l'université. Certains étudiants en situation précaire y ont accès grâce à des bourses, tandis que d'autres doivent débourser pour leur éducation.

Duince Ahossouhe, président du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin et propriétaire de la ferme Village moderne de Kétou
Duince Ahossouhe, président du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin et propriétaire de la ferme Village moderne de Kétou







Les palmiers à l'huile sont couramment cultivés au Bénin, mais une grande partie de l'huile de palme produite au pays est envoyée à l'extérieur du pays, faute d'installations de transformation.
Les palmiers à l'huile sont couramment cultivés au Bénin, mais une grande partie de l'huile de palme produite au pays est envoyée à l'extérieur du pays, faute d'installations de transformation.

Grâce à l'intervention de la relève québécoise, Duince Ahossouhe pourrait bien utiliser ses porcs pour labourer plus rapidement son champ, l'an prochain.
Grâce à l'intervention de la relève québécoise, Duince Ahossouhe pourrait bien utiliser ses porcs pour labourer plus rapidement son champ, l'an prochain.

La fin de la saison sèche concorde avec la saison des mangues, au Bénin.
La fin de la saison sèche concorde avec la saison des mangues, au Bénin.

Au Bénin, les bœufs pâturent en liberté, là où l'herbe pousse.
Au Bénin, les bœufs pâturent en liberté, là où l'herbe pousse.

Romain Junior Adogoni, à Porto-Novo, a choisi la pisciculture de poisson-chat et de tilapia.
Romain Junior Adogoni, à Porto-Novo, a choisi la pisciculture de poisson-chat et de tilapia.

Les ananas comptent parmi les cultures les plus productives à l'hectare, au Bénin.
Les ananas comptent parmi les cultures les plus productives à l'hectare, au Bénin.
4
Plus de la moitié du pays sans électricité
En 2020, seulement 41,4 % de la population béninoise avait accès à l’électricité, selon la Banque mondiale. L’accès est d’autant plus difficile en zone rurale, où les ménages utilisent en majorité la combustion de bois ou de résidus végétaux pour la préparation des aliments.
« Il y a encore des fermes sur lesquelles vous allez partir et sur lesquelles il n’y a pas d'accès à l’énergie. Comment faire pour que le travail soit attrayant en milieu rural si le jeune ne peut même pas charger son téléphone pour se connecter et voir l’actualité? C’est un des défis pour nous aujourd’hui », note M. Ahossouhe.

La combustion de bois et de déchets organiques demeure la source d'énergie principale pour la préparation alimentaire. Même les entreprises de transformation y ont recours.
La combustion de bois et de déchets organiques demeure la source d'énergie principale pour la préparation alimentaire. Même les entreprises de transformation y ont recours.
Des panneaux solaires, qui peuvent notamment alimenter des pompes servant à l’irrigation des cultures ou des abreuvoirs, ont aussi commencé à apparaître sur certaines fermes, mais ne peuvent pas répondre à tous les besoins énergétiques.
« La plupart de ceux qui nous installent les équipements solaires ne dimensionnent pas bien au point que les équipements ne sont pas performants après installation, note le jeune agriculteur. Deuxièmement, les équipements coûtent encore bien cher et sont très peu accessibles pour les populations rurales. On a aussi souvent l’impression que les équipements envoyés en Afrique sont de piètre qualité. »

5
Rêves politiques



Le coton est une importante filière pour l'économie du Bénin.
Le coton est une importante filière pour l'économie du Bénin.
Le président Patrice Talon, qui a été élu pour la première fois en 2016, a lui-même fait fortune dans le domaine agricole, plus précisément dans le domaine du coton.
Le programme d’action de son gouvernement cherche à accroître la productivité et la production agricole, renforcer la résilience des populations vulnérables face aux changements climatiques, augmenter la sécurité alimentaire et miser sur des chaînes de valeur ajoutée qui passent notamment par la production, la transformation et la commercialisation à même le pays.
En stimulant les investissements privés, il espère également diversifier les exportations du Bénin, qui sont surtout dominées par l’industrie du coton à l’heure actuelle.

Le gouvernement a d’ailleurs légiféré en février dernier pour taxer les exportations de certains produits. Des barrières douanières allant jusqu’à 20 % pour les produits en forte demande au pays sont appliquées sur le coton, le soja, le manioc (même transformé), le karité, le riz, l’igname et la noix de cajou.
Des discussions sont également en cours pour interdire l’exportation de produits bruts qui pourraient être transformés au pays et générer davantage d’activité économique.
En 2021, le pays déclarait 1846,8 milliards de Francs CFA (4,1 G$ CAN) en importations, contre seulement 568,8 milliards de Francs CFA (1,2 G$ CAN) en exportations. La situation est particulièrement critique dans le secteur agricole, qui comporte d’importants déficits notamment dans les céréales, les viandes ainsi que les poissons et crustacés.

Le Canada en appui
Le Canada entretient des relations bilatérales avec le Bénin depuis 60 ans, mais y a installé un bureau de coopération en 2017 notamment afin d’y intervenir dans les domaines de la santé, l’agriculture, la microfinance, la formation professionnelle et l’appui des droits des femmes.
La chef de coopération pour le Canada au Bénin, Myriam Pierre-Louis, explique agir en appui à la vision agricole du président Talon, qui en est à son deuxième mandat.
Pour Mme Pierre-Louis, la guerre en Ukraine et la hausse du prix du blé ont justement ajouté à la motivation d’aider le pays à atteindre la sécurité alimentaire en misant sur ses productions locales.
« Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes, mais ce n’est pas évident de les intéresser à l’agriculture, avance Mme Pierre-Louis. Il y a le problème aussi de grands voisins comme le Nigeria qui est à côté, qui a des besoins et qui est prêt à payer beaucoup aux producteurs rapidement. Il y a une partie de la production qui devrait demeurer sur le marché local et qui sort du pays. »
La première secrétaire du bureau canadien de coopération, Chloé Simard, ajoute qu’un des problèmes est que les Béninois se tournent énormément vers les produits étrangers, notamment en raison du prix souvent plus avantageux.
Par exemple, le riz asiatique est celui qui est le plus consommé au pays. Des projets sont d’ailleurs en cours en collaboration avec le Canada pour soutenir des groupes de femmes dans la filière du riz.
Le Canada pense-t-il bénéficier de plus grands échanges commerciaux avec le Bénin, à long terme? Du côté agroalimentaire, pas tellement, répond Mme Pierre-Louis, qui précise que les échanges se font actuellement dans des secteurs d’expertise de pointe, comme l’aéronautique par exemple.
« C’est vrai qu’il y a une volonté politique aussi de transformer davantage les produits avant de les exporter, poursuit Chloé Simard. Il y a des possibilités dans le futur d’échanges commerciaux avec une valeur ajoutée finalement localement, par exemple avec la noix de cajou. »

Chloé Simard et Myriam Pierre-Louis, respectivement première secrétaire et chef du bureau de coopération pour le Canada au Bénin
Chloé Simard et Myriam Pierre-Louis, respectivement première secrétaire et chef du bureau de coopération pour le Canada au Bénin

Mme Pierre-Louis a reçu la délégation de la Fédération de la relève agricole du Québec ainsi que les représentants du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, lors de leur visite au pays.
Mme Pierre-Louis a reçu la délégation de la Fédération de la relève agricole du Québec ainsi que les représentants du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, lors de leur visite au pays.
Pendant deux semaines, neuf jeunes de la relève agricole québécoise ont traversé le Bénin dans l’optique de tisser des liens qui aideront le pays à défendre son agriculture familiale en contexte de changements climatiques, de mondialisation et de course à la croissance économique. La Tribune les a accompagnés et y a fait la découverte des élevages, des cultures et des humains qui constituent la résilience béninoise. Ce reportage a été rendu possible grâce à Affaires mondiales Canada et UPA Développement international.
